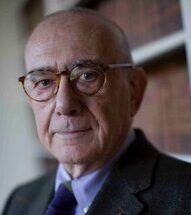Dans la plupart des pays européens, on redoutait l’élection de Donald Trump. Nous avons été gâtés : il a triomphé bien plus facilement qu’on ne le prévoyait pendant le mois précédant le scrutin. L’ampleur de son succès, l’étrangeté de sa personne, l’incertitude sur la politique que les États-Unis mèneront, les conséquences prévisibles et imprévisibles qu’elle entraînera alimentent le trouble et la crainte qu’éprouvent les Européens.
Mais, au-delà de ces sentiments légitimes qui justifient le titre sous lequel nous réunissons les articles qui suivent, un problème historique se pose peut-être. Après la conversation téléphonique entre Trump et Poutine, après la réunion qui s’est tenue entre Américains et Russes en Arabie saoudite, après les propos scandaleux que vient de tenir le Président américain à propos de Volodymyr Zelensky, en prétendant que l’Ukraine a causé et déclaré cette guerre et qu’elle est dirigée par un dictateur, autrement dit après avoir parlé comme parle Poutine, dont l’actuel secrétaire d’État américain, Marco Rubio, disait il y a trois ans qu’il était « un menteur professionnel », après tout cela que doivent penser les Européens ?
Trump est-il devenu l’allié, voire le complice ou le jouet de Poutine ? Plus profondément, s’agit-il d’un épisode guérissable en deux ans ou bien de la remise en cause des rapports de sécurité collective entre la démocratie des États-Unis d’Amérique et les démocraties de l’Europe ?
Ces rapports de confiance se maintiendront-ils tels qu’ils ont été définis par la charte de l’Atlantique du 14 août 1941 entre Roosevelt et Churchill, puis par la doctrine Truman de 1947 aboutissant, après le plan Marshall destiné à reconstruire l’Europe, au traité de Bruxelles créant l’OTAN le 4 avril 1949 ?
En écoutant Trump, on songe au vote du Sénat américain contre le Président Wilson le 19 mars 1920 pour rejeter le traité de Versailles et la Société des Nations. Wilson était sorti de l’isolationnisme en mai 1916 en affirmant que les intérêts de toutes les nations libres étaient ceux des États-Unis. Trump pense-t-il l’inverse ? Que les intérêts de Poutine et les siens coïncident ? L’Amérique pense-t-elle que ses intérêts sont les mêmes que ceux de la Russie actuelle ?
Le vice-Président des États-Unis, James David Vance, s’est rendu à Munich pour la conférence sur la sécurité, le 14 février dernier. Il a demandé aux Européens de dépenser davantage pour leur défense. Demande légitime. Beaucoup de pays se sont reposés à l’abri du bouclier américain, sans prendre leur propre part à la défense collective.
Il leur a demandé de contrôler l’immigration, à l’instar désormais des États-Unis. Saluons un langage nouveau de la part de Washington qui, depuis cinquante ans, ne cessait de vanter les bienfaits de l’immigration au point d’en convaincre la bureaucratie de Bruxelles.
Il a également engagé les Européens à respecter la liberté d’expression. Même si les interprétations de notre Déclaration des droits peuvent être plus élastiques que celles du Premier Amendement de la Constitution américaine, texte contemporain,
on peut partager l’opinion de Vance, car il est vrai que trop d’intellectuels des deux côtés de l’Atlantique sont tentés par le « wokisme » des universités américaines et proposent de passer du « politiquement correct » au « politiquement obligatoire ».
Mais pourquoi le vice-Président a-t-il lui-même réduit sa liberté d’expression en matière de sécurité collective dans une conférence exclusivement consacrée à la sécurité collective ?
Silence bien étrange, bien inquiétant, même si l’on considère que sa prudence – on dira même son obédience – s’explique par la perspective électorale qui s’ouvrira pour lui en 2028.
C’est que les silences de Vance et les paroles de Trump semblent annoncer une rupture historique.
S’agit-il d’un épisode chaotique qui s’éteindra quand le fauteur de troubles perdra la confiance du peuple américain aux élections du midterm ? À condition qu’il perde effectivement et que les dégâts produits en deux ans soient réparables.
Pire encore, s’agit-il d’une rupture définitive entre l’Europe et les États-Unis puisque, pour la première fois dans leur histoire, les Américains renonceraient à défendre la liberté ?
Pour écarter cette dernière hypothèse, pour déplorer le présent il faut se conforter en songeant au passé. Oublions un instant Roosevelt et Truman, l’un et l’autre fondateurs de la communauté atlantique et qui étaient membres du Parti démocrate, constatons que Trump dans le Bureau ovale a placé le portrait de Reagan. Peut-il croire un instant que Reagan l’approuverait ? Devons-nous croire qu’au sein du Parti républicain, le souvenir de Reagan a disparu, comme celui de son successeur George Bush qui, vice-Président depuis 1980, devint Président en 1988, acheva la Guerre froide et contribua à réunifier l’Allemagne ?
Mieux encore, William Kristol a invoqué récemment un discours de Lincoln, le plus illustre Président des États-Unis après Washington, la plus noble figure du « Grand Old Party », du Parti républicain. Ce discours, tous les Américains éduqués le connaissent, à commencer par Vance. Dans le silence de son cabinet, le médite-t-il avec remords ? En fera-t-il percevoir le sens à l’hôte de la Maison-Blanche ? Ou bien pensera-t-il que l’idée de la liberté lui est étrangère, puisque les États-Unis renoncent à défendre un peuple qui lutte pour sa liberté ?
Voici ce texte, pour montrer au lecteur français le contraste qui existe désormais aux États-Unis entre la grandeur et la bassesse en politique :
Le sentiment prédominant de monsieur Clay, du début jusqu’à la fin de sa vie, fut une profonde dévotion à la cause de la liberté humaine, une forte sympathie pour les opprimés du monde entier et un désir ardent de les élever. Chez lui, c’était une passion primordiale et déterminante. Il en déduisait la conduite de toute sa vie. Il aimait son pays en partie parce que c’était le sien, mais surtout parce que c’était un pays libre ; et il brûlait de zèle pour son progrès, sa prospérité et sa gloire, parce qu’il y voyait le progrès, la prospérité et la gloire de la liberté humaine, du droit de l’homme et de la nature humaine. Il souhaitait la prospérité de ses compatriotes en partie parce qu’ils étaient ses compatriotes, mais surtout pour montrer au monde que les hommes libres pouvaient être prospères1.
En définitive, comment tiendrons-nous le flambeau ? De deux choses, l’une : ou bien l’Europe retrouvera avec l’Amérique l’alliance sur laquelle elle s’est reconstruite et a commencé à s’unifier, ou bien elle poursuivra seule le chemin. Le voudra-t-elle ? Le pourra-t-elle ?
20 février 2025