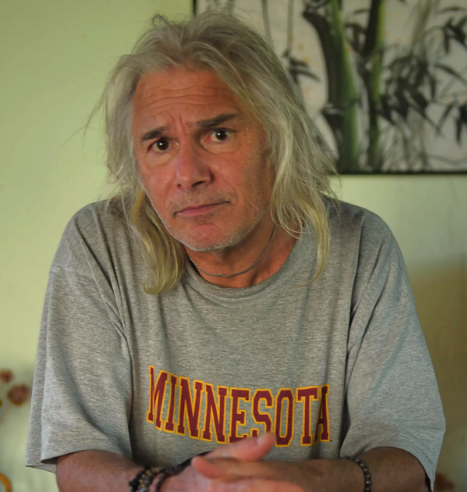Il existe un mythe Kafka, et le romancier pragois est sans doute le seul écrivain du xxe siècle à avoir donné naissance à un adjectif couramment utilisé, et dont la portée n’est pas uniquement littéraire. Quant à savoir si cet adjectif, quand il est employé, ne relève pas du contresens, j’y reviendrai plus loin. Le mythe Kafka tient à plusieurs raisons : le mystère de l’homme ; le fait qu’il ait très peu publié de son vivant (un peu plus qu’on ne l&
Un nouvel et vrai Kafka
Il existe un mythe Kafka, et le romancier pragois est sans doute le seul écrivain du xxe siècle à avoir donné naissance à un adjectif couramment utilisé, et dont la portée n’est pas uniquement littéraire. Quant à savoir si cet adjectif, quand il est employé, ne relève pas du contresens, j’y reviendrai plus loin.
Le mythe Kafka tient à plusieurs raisons : le mystère de l’homme ; le fait qu’il ait très peu publié de son vivant (un peu plus qu’on ne l’imagine, quand même) ; que ses trois romans soient restés inachevés ; et qu’ils étaient voués à la destruction. Que sans son ami Max Brod, exécuteur testamentaire infidèle, on ne les aurait jamais lus. Que certains lecteurs – peu perspicaces – aient vu dans ces livres une préfiguration du monde totalitaire ; qu’Albert Camus, en France – assez peu perspicace lui aussi –, ait considéré Kafka comme un prophète de l’Absurde.
Les études sur Kafka se sont multipliées au cours des soixante dernières années, comme une glose infinie étouffant sous son poids une œuvre relativement brève.
La première édition de Kafka en Pléiade, due à Claude David, date de 1976. Elle était insatisfaisante, de bien des façons, et c’est une bonne idée que d’avoir confié au germaniste émérite qu’est Jean-Pierre Lefebvre (par ailleurs l’auteur d’un unique et beau roman, La Nuit du passeur, paru en 1989) le soin de procurer une édition nouvelle, dans des traductions nouvelles, basées sur un état des textes différent en ce qui concerne les romans (depuis quarante ans, des fragments ont ressurgi, et les études kafkaïennes ont permis de restituer à chacun des titres de la « trilogie » une forme sans doute plus proche de celle que souhaitait Kafka), et, dans le cas des nouvelles, les organisant en un classement plus logique et plus accessible.
L’édition de 1976, de façon un peu maladroite, reprenait les traductions canoniques d’Alexandre Vialatte – à qui on doit la révélation de Kafka en France – en les affublant de corrections, pas toujours heureuses, et qui parfois sentaient le pion, mouchetant le texte d’appels de notes inélégants.
Les traductions de Vialatte, faites sur les états des textes disponibles à l’époque, n’étaient pas parfaites (quelle traduction peut se targuer de l’être ?), mais il restera un défricheur et un lecteur de Kafka exceptionnellement lumineux (on peut lire dans Kafka ou l’Innocence diabolique l’ensemble des articles qu’il a consacrés à son « champion »). Il faut cependant reconnaître que les traductions de Jean-Pierre Lefebvre, plus fluides, sans doute plus précises, rendent mieux justice à l’écriture de Kafka, ce qui fait qu’il est un romancier, et pas un philosophe.
Mais le grand bénéfice de cette nouvelle édition tient principalement à la façon dont sont organisés les nouvelles et autres fragments narratifs de Kafka. Claude David avait choisi de les donner par ordre chronologique, sans respecter la façon dont Kafka en avait assemblé certains en volumes, sans séparer les textes parus du vivant de Kafka des textes posthumes, sans traiter de façon différente les textes achevés des fragments, parfois très brefs, extraits de son Journal. Il en résultait un patchwork composite, dans lequel les récits les plus célèbres (La Métamorphose, par exemple) apparaissaient sur le même plan que des lambeaux de quelques mots arrachés au Journal, et dépourvus de titre. Seules quelques lignes de blanc séparaient les textes, et la table des matières alignait sur 12 pages un indigeste fatras d’incipit imprimés en italiques, au milieu desquels surgissaient, au hasard de la chronologie, imprimés en romain, les titres des récits menés à bien, et « baptisés » par Kafka.
Jean-Pierre Lefebvre, lui, a choisi de reconstituer les recueils voulus par l’auteur, puis de les faire suivre d’une deuxième section comprenant les textes parus dans des revues du vivant de Kafka, réservant ses troisième et quatrième sections aux « fragments » extraits du Journal, ou d’autres « cahiers » retrouvés. Et il précise que ces textes narratifs apparaîtront une deuxième fois, dans la nouvelle édition à venir du Journal, afin de ne pas amputer ledit Journal. Un choix rigoureux, qui restitue à l’œuvre de Kafka sa véritable forme, et épargne au lecteur un pénible morcellement.
Un dernier point qui fait de cette nouvelle édition une grande réussite : Jean-Pierre Lefebvre a décapé Kafka de la glose qui l’obscurcissait. L’édition précédente alourdissait chaque chapitre des romans d’une interminable notice, analysant, interprétant chaque symbole, et rendant Kafka plus cryptique qu’il ne l’est. Aujourd’hui, chaque roman bénéficie d’une notice unique, concise, suivie de notes qui ne sont pas pléthoriques. Ainsi, le volume consacré aux romans dans l’édition précédente faisait 1 350 pages, dont 600 de notes et notices. L’édition nouvelle ne « pèse » plus que 1 050 pages, et la part des notes ne comprend que 150 pages : Kafka en ressort régénéré, comme un tableau restauré qui retrouve sa vie et son éclat.
J’avais, comme tout le monde, découvert Kafka à 18 ans, avec une naïveté qui me faisait prendre au pied de la lettre tous les commentaires convenus sur le sens de son œuvre, et sur ce qu’il convenait d’en penser. Je ne l’avais pas rouvert depuis, et, à l’occasion de cette nouvelle Pléiade, j’ai relu les trois romans. Sans enthousiasme excessif, mais avec beau coup de respect pour la cohérence de cette « trilogie », et une vision nouvelle sur les interprétations qu’elle peut susciter.
Le Disparu (longtemps connu sous le titre d’Amérika, que lui avait donné Max Brod), première tentative au long cours de Kafka, est son roman le plus abordable, le plus « classique ». Il s’était donné pour modèle David Copperfield, et Le Disparu est en effet un roman d’éducation assez traditionnel, qui conduit en Amérique, où il ira d’échec en échec – sans qu’il y ait entre ces échecs successifs une véritable progression narrative et psychologique –, un jeune garçon coupable d’avoir fait un enfant à la servante de ses parents. Kafka y respecte encore les lois du roman réaliste, et son Amérique de fantaisie est une Amérique telle que pouvait l’imaginer et la peindre un Pragois qui n’y avait jamais mis les pieds.
On y trouve déjà ce qui sera au cœur du Procès et du Château : la notion d’une culpabilité, d’une faute à expier, qui conduit le personnage dans les arcanes d’une loi qui lui reste incompréhensible.
Cette notion de faute, et de loi, est le plus clairement visible – et lisible – dans Le Procès, où Kafka se débarrasse des oripeaux du réalisme – aussi fantaisiste soit-il – et se concentre sur la création d’un univers chargé de symboles. Les décors de carton-pâte de L’Amérique sont oubliés, et l’écrivain découvre l’efficacité d’une abstraction qui culminera avec Le Château. Le Procès est un roman parfaitement maîtrisé, avec une ligne plus nette que Le Disparu : à la différence du jeune Karl Rossmann, le Joseph K. du Procès évolue, et en arrive à comprendre et à accepter l’existence d’une loi non écrite – la loi, même si ce n’est jamais dit, de la religion juive, la loi de la Torah, celle de l’Ancien Testament, et de l’expiation du péché originel. Joseph K., comme tous les hommes, est condamné dès sa naissance : la mort est la conséquence inéluctable de la faute initiale, celle d’être né.
Les interprétations délirantes – Kafka prophétisant les systèmes totalitaires ; Kafka chantre de l’« absurde », alors que chez lui tout obéit à une implacable logique ; les interrogations sur la faute commise sur Joseph K., sur son innocence ou sa culpabilité – relèvent d’un total contresens. Kafka n’est ni un visionnaire, ni un auteur fantastique, ni un amateur de psychologie.
Il est l’auteur religieux par excellence, en quête de la compréhension de la loi ultime, celle qui gouverne la vie et conduit à la mort.
Si l’on pouvait encore reconnaître dans Le Procès certains endroits de Prague – même si la ville n’est jamais nommée –, Le Château va encore plus loin dans l’abstraction, et le héros, K., n’a même plus de prénom. Cet arpenteur convoqué par le maître du château, et qui n’arrivera jamais à pénétrer dans le château, ni à voir son maître (tout au plus aperçoit-il fugitivement Klamm, son représentant, mais s’agit-il bien de lui ?), c’est toujours l’homme à la recherche du Dieu. Aucun « absurde » là-dedans, mais la quête interminable du sens d’une loi aussi logique qu’incompréhensible à des yeux de profane, métaphore d’une croyance inaccessible, d’une foi qui ne s’explique pas.
Au fil de ses trois romans, Kafka va de plus en plus loin dans l’abstraction, on l’a dit, et dans la tentative désespérée d’atteindre le Dieu caché qui gouverne nos vies.
Ses romans sont des paraboles religieuses, de plus en plus complexes, de plus en plus labyrinthiques – si Le Procès s’achevait par une acceptation sereine de la mort, par un apaisement de Joseph K. croyant enfin comprendre, Le Château est une toile d’araignée étouffante, et chaque étape nouvelle révèle de nouveaux détails d’un plan d’autant plus obscur qu’il est plus impitoyablement précis.
Les romans de Kafka, paraît-il – Vialatte, déjà, l’affirmait –, sont écrits dans une langue d’une absolue pureté, dépouillée de toute séduction de surface, comme traduits de l’invisible. Aucune traduction, donc, aussi bonne soit-elle, ne pourra rendre justice à son écriture radicalement neuve, ce dont on se rend mal compte en français.
Alexandre Vialatte soulignait son humour, sa drôlerie : « S’il sent la condition humaine avec le frisson de Pascal, il les traduit avec les ressources de Courteline et d’un humoriste foncier. » Plus loin, il le compare à Chaplin, et il est vrai qu’il y a quelque chose du slap-stick dans les deux « aides » de K., dans la façon dont leurs corps se contorsionnent, dont ils subissent toutes les avanies que K. leur fait subir pour toujours en ressurgir, semblables à eux-mêmes, indestructibles.
De là à dire que Kafka est un auteur irrésistiblement comique, il y a un pas que je ne franchirai pas, et parfois ses paraboles, ses interminables dialogues (surtout dans Le Château) ennuient.
Dernière chose : l’adjectif « kafkaïen ». S’il est employé dans le sens d’absurde, il s’agit, je l’ai dit, d’un contresens. S’il est employé pour désigner les incompréhensibles ramifications d’une administration toute-puissante, alors oui, il est justifié, car ce sont les ramifications de cette administration tatillonne et aveugle – mais aveugle par excès de logique – qui apporteront la lumière à celui qui, enfin, parviendra à en saisir le sens, à atteindre le Dieu. Mais réduire l’œuvre de Kafka à une caricature de l’administration, c’est quand même le considérer par le petit bout de la lorgnette, par son côté courtelinesque. En réalité, ce mystique en quête d’un Dieu ne parle pas du monde actuel. Il est un éternel candidat à la foi, et à l’apaisement de l’éternité.
La suite est réservée aux abonnés ayant un abonnement numérique + archives...
Continuez à lire votre article en vous abonnant ou en achetant l'article.
Je suis abonné ou j'ai déjà acheté l'article