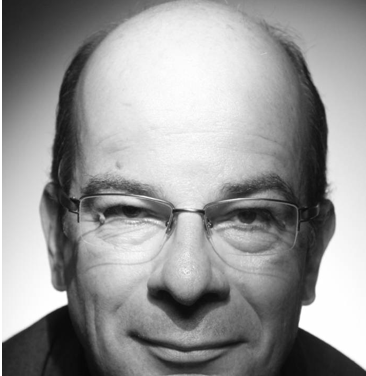Il ne va pas de soi de comparer le sort des médecins et des enseignants, que leurs options politiques, souvent différentes, et la rivalité entre professions libérales et service public séparent plus volontiers qu’elles ne les rapprochent. En se plongeant dans leur histoire, Vincent Feré parvient pourtant à retracer les destins parallèles de ces deux professions en crise.
Commentaire
On a rarement songé à comparer la médecine et l’enseignement : d’abord parce que les deux activités n’ont aucun rapport dans leur objet, ensuite parce que médecins et enseignants appartiennent à deux univers très différents. Sociologiquement, celui des professions libérales, entendant bien rester telles contre toutes les tentatives d’étatisation, s’oppose à celui des fonctionnaires, attachés au service public et farouchement hostiles à toute privatisation ; politiquement, le vote majoritairement à droite des médecins contraste avec celui majoritairement à gauche des enseignants.
Et pourtant le parallèle se justifie : tous souffrent de la faible attractivité et de la perte du sens de ces deux métiers dont les gestionnaires au pouvoir ont jugé qu’ils pourraient, plus efficacement peut-être et à moindre coût sûrement, s’exercer sans médecin et sans professeur. Dans les deux cas, un même résultat : des déserts médicaux et pédagogiques, et un sentiment d’abandon chez les Français les plus modestes ou les plus éloignés des grandes métropoles, qui ne peuvent plus accéder gratuitement comme jadis à des soins et à un enseignement de qualité, privatisation oblige. Sans doute aussi n’a-t-on pas encore tiré les leçons de l’épidémie de Covid-19, qui a montré non seulement la fragilité de nos systèmes de santé et d’éducation, longtemps cités en exemples, mais également que, malgré l’apport des nouvelles technologies, soigner sans médecin et enseigner sans professeur relevait d’une impossible gageure. L’enjeu est en réalité politique : la crise de ces professions apparaît en effet comme un miroir de celle d’une société française dont la fracturation alimente le vote protestataire ou l’abstention.
La pandémie nous aura du moins rappelé que, dans un monde où la question de la transmission du savoir est plus décisive que jamais, où le droit à la santé d’une population toujours plus nombreuse et vieillissante est un acquis irréversible, l’avenir commun ne s’écrira pas sans ces deux métiers dont la nécessaire évolution est la condition de leur pérennité.
Deux vocations en crise
Aujourd’hui encore, médecine et enseignement sont considérés comme une affaire de vocation. Comme le prêtre, le médecin et l’enseignant n’ont pas choisi un métier ; ils ont répondu à un appel et ils accomplissent des missions nobles entre toutes : soigner et instruire. La dimension religieuse des deux professions ne fait d’ailleurs pas de doute et elle est inscrite dans leur histoire. Quand naît la médecine en Grèce au ve siècle av. J.-C. avec Hippocrate, elle a sa divinité, Asclépios, et au sanctuaire d’Épidaure ses prêtres plutôt que ses médecins. Quant à l’enseignement, des monastères et des écoles épiscopales aux universités, il a d’abord été le fait des religieux dans l’Occident médiéval. La santé comme le savoir touchent donc au divin, ceux qui en font profession aussi, d’où leur prestige.
Pourtant, cette proximité avec le sacré a longtemps valu aux uns et aux autres une réputation de charlatanisme. Dans le fond, on considérait que, sans formation, et avec quelques dons, n’importe qui saurait soigner et enseigner. Les médecins de Molière ne savaient pas grand-chose mais, l’habit faisant le moine, Sganarelle pouvait sans peine se hisser au niveau de Diafoirus. Sous l’Ancien Régime, les maîtres des petites écoles, quand ce n’était pas le curé, étaient presque aussi ignorants que leurs élèves, et il fallut attendre 1816 et surtout la loi Guizot (1833), qui généralisa l’enseignement primaire, pour que l’on exigeât d’eux un brevet de capacité.
Pour gagner leurs lettres de noblesse, ces deux professions ont donc dû s’organiser et se structurer. Elles l’ont fait en Occident en adoptant le modèle corporatif, comme l’a bien montré Jacques Le Goff dans ses Intellectuels au Moyen Âge1 à propos des universités. Qui dit corporation dit hiérarchisation du savoir – le trivium et le quadrivium – et des grades – on est licencié puis docteur après avoir été officiellement reçu à des examens –, mais également lutte contre la concurrence déloyale : il a fallu les progrès de l’anatomie au xvie siècle pour que le chirurgien, avec Ambroise Paré, se distingue du vulgaire barbier. Vocations certes, soigner et instruire sont ainsi devenus des « métiers » qui supposent une qualification.
Notons au passage que, pour acquérir cette légitimité, la médecine et l’enseignement ont dû rompre peu à peu avec leurs origines religieuses. La laïcisation des deux professions s’est d’ailleurs accompagnée, au xixe siècle, d’un fort anticléricalisme commun aux médecins et aux enseignants. Dans la tradition du pharmacien Homais de Flaubert qui, dans Madame Bovary, fustige les prêtres, les « intellectuels de chefs-lieux de canton » chers à Thibaudet au début de la IIIe République, républicains et souvent radicaux sont indifféremment médecins ou enseignants. Les uns et les autres appartiennent ainsi au monde des notables. Leurs professions, symboles de réussite sociale et gages de considération, ont donc longtemps été attractives. Leur professionnalisation et leur laïcisation n’ont toutefois pas fait disparaître toute trace de leurs origines religieuses, soigner et enseigner étant encore considérés aujourd’hui comme des vocations plus que comme des métiers.
Cette vocation, c’est là une autre ressemblance entre les deux activités, a souvent été héréditaire. Combien de médecins et d’enseignants exercent le métier de leurs parents, marqué par une très forte homogamie jointe à une non moins forte endogamie ? Se sont ainsi constitués au fil des générations un corps médical et un corps enseignant – le vocabulaire corporatif encore ! Leur syndicalisme, dans les deux cas, se caractérise d’ailleurs par un corporatisme farouche. Paradoxe pourtant, ces métiers, fermés dans leur recrutement, sont ouverts sur la société : la médecine ne s’exerce pas plus dans les laboratoires que l’enseignement dans les bibliothèques. Le savoir des uns et des autres est au service de la société et les deux professions relèvent bien du secteur tertiaire.
Enfin, elles ont aujourd’hui un autre point commun : elles connaissent une très sévère crise de recrutement. S’agissant de l’enseignement, c’est une évidence et, dans certaines disciplines, la question devient même préoccupante. On n’en finirait plus d’aligner les chiffres qui en attestent : division par cinq en trente ans du nombre de postulants à l’agrégation d’histoire, effondrement du nombre et du niveau des candidats dans les matières scientifiques… Le sociologue François Dubet le reconnaît : « Ce ne sont plus les meilleurs étudiants (…) et, en science, ce ne sont non seulement pas les meilleurs mais ce sont souvent les moins bons2 » qui passent les concours de recrutement. Et ce spécialiste de l’école de s’en étonner : « Avec un chômage de 25 %, une telle profession dans la fonction publique devrait attirer. Ce n’est plus le cas et c’est une énigme. » Autre symptôme de la perte de prestige du métier : sa féminisation et le recours à des populations issues de l’immigration.
On pourrait répondre à cela que le domaine médical ne souffre pas du même désamour, puisque d’année en année les candidats au Parcours d’accès spécifique santé (PASS) sont toujours aussi nombreux. Sans doute, mais la médecine de proximité, la médecine générale et les services publics hospitaliers connaissent la même tendance que l’enseignement : la féminisation de la profession et l’appel aux immigrés.
Classes sans enseignants, déserts médicaux… on imagine sans peine les conséquences sociales d’une telle situation qui concerne d’abord, naturellement, la « France périphérique » (Christophe Guilluy). Le modèle social français, conjonction du « modèle républicain » (Serge Berstein) – celui de l’égalité des chances et de l’école républicaine, gratuite et égalitaire pour tous – et de l’État providence, garantissant un accès égal et gratuit aux soins pour chacun, a vécu. Aux grandes métropoles les grands lycées, les professeurs (encore) agrégés, les bons hôpitaux et cliniques avec les meilleurs spécialistes ; aux banlieues, aux villes moyennes et à la France rurale les établissements scolaires gangrenés par la violence, les urgences saturées ou rien du tout.
Médecine et enseignement sont donc un parfait miroir de la crise sociale française dont on connaît les conséquences politiques : la montée du populisme et l’affirmation d’un « nouveau clivage » dont Jérôme Fourquet a proposé une très précise analyse géographique et sociologique3.
Face à l’évidence de cette crise, la réponse des pouvoirs publics, depuis plusieurs décennies, n’est pourtant pas à la hauteur des enjeux.
La réponse inadaptée des pouvoirs publics
Les pouvoirs publics ont enfin pris conscience d’une nouveauté : ils ne peuvent plus compter comme jadis sur le vivier des enfants de médecins et d’enseignants. Comme le constate encore François Dubet : « Les enfants de professeurs sont ceux qui souhaitent le moins le devenir4. » Ils ont donc imaginé d’autres remèdes à la crise des vocations.
Mais quels qu’ils soient, ces remèdes témoignent surtout d’une ignorance profonde – d’un mépris ? – de ces deux professions et du malaise qui les touche. Pour résoudre la pénurie de personnel, niant que la médecine et l’enseignement sont des métiers, on a considéré, étrange retour en arrière, que n’importe qui ou presque pouvait faire office de médecin ou d’enseignant. Il y a vingt-cinq ans déjà, l’Éducation nationale proposait ainsi aux femmes ayant eu trois enfants d’être dispensées de la licence pour entrer à l’école normale d’institutrices ! Danièle Sallenave s’en indignait dans un vigoureux petit essai5 mais l’indifférence générale prévalait alors, y compris chez les féministes qu’on aurait pu imaginer s’insurger contre cette vision « genrée » de la profession enseignante. Depuis lors, rien ne s’est arrangé et, à la rentrée 2022, certains rectorats ont inauguré des « speed datings » pour tenter de trouver dans l’urgence des personnels sans aucune formation à mettre devant les élèves. La médecine n’est pas épargnée non plus, et voilà qu’on aimerait autoriser les pharmaciens à vacciner – mais y aura-t-il encore demain des pharmacies de proximité ? – et les infirmières à pratiquer certains actes médicaux comme le renouvellement des ordonnances.
Autre stratégie des pouvoirs publics : la mise en accusation. Il n’y a pas, prétend-on, de difficulté particulière à enseigner en banlieue à des publics hétérogènes, mais simplement des professeurs qui s’obstinent encore, Dieu seul sait pourquoi, à vouloir transmettre des connaissances, et qui ne savent pas s’adapter. Depuis trente ans, le discours pédagogiste comme celui de l’administration de la Rue de Grenelle visent à culpabiliser l’enseignant et à excuser le perturbateur. Et l’on feint, comme François Dubet, de s’étonner de la perte d’attractivité du métier !
Voilà donc les enseignants et leur statut datant des années cinquante considérés comme les principaux artisans des échecs du système éducatif. En pareilles circonstances, le remède proposé est extrêmement simple : abolir ledit statut et donner aux chefs d’établissement le pouvoir de choisir et d’évaluer leurs professeurs. Mais en quoi cette seule réforme permettrait-elle miraculeusement de résoudre la question du recrutement ?
Quant aux médecins, rendus responsables du déficit de la Sécurité sociale à cause de leurs prescriptions, personne ne comprend très bien non plus pourquoi ils répugnent à s’installer dans les zones sensibles où leurs cabinets sont régulièrement vandalisés, ou dans les zones rurales qui exigeraient de leur part 70 à 80 heures de travail hebdomadaire. On a pu d’ailleurs mesurer l’ignorance de la technocratie au pouvoir lorsque Marisol Touraine, alors ministre de la Santé, pour inciter les généralistes à peupler les « déserts médicaux » promettait de leur garantir 5 000 euros mensuels quand l’exercice de leur profession dans ces territoires abandonnés leur en assurait le double. Du reste, après l’incitation revient régulièrement dans les propositions de l’administration l’obligation pour les médecins d’aller, un temps au moins, exercer dans les zones oubliées.
Soulignons également, à l’école comme à l’hôpital, une pression toujours plus grande de la hiérarchie administrative, elle-même soumise à des injonctions souvent absurdes de rentabilité, et source d’un profond mal-être au travail. Déjà en 2018, avant la crise de la Covid-19, deux médecins, Philippe Halimi et Christian Marescaux6, dénonçaient les effets dévastateurs d’un système hospitalier qui oblige à soigner vite pour être rentable. Une logique purement comptable qui conduit à diminuer les effectifs et les moyens, au prix souvent du harcèlement sur les personnels qui préfèrent démissionner quand ils le peuvent.
Récemment enfin, aucune leçon n’ayant été tirée de la crise sanitaire, le ministre de la Santé comme celui de l’Éducation nationale ont conditionné la hausse des rémunérations des soignants et des professeurs à l’acceptation de nouvelles tâches, administratives le plus souvent, ne relevant donc ni de la médecine ni de la pédagogie, sans qu’il soit question de diminuer – au contraire ! – la tutelle de la bureaucratie sur ces professions sous haute surveillance puisque coupables, forcément coupables, du déficit des comptes sociaux et des échecs de l’école. Si l’on voit mal en quoi demander à des médecins de faire le travail de la Sécurité sociale ou à des enseignants de remplir d’improbables tableaux Excel montrant la conformité de leurs « projets » aux dernières injonctions ministérielles permet d’améliorer la santé des malades et le niveau des élèves, on voit très bien en revanche pourquoi ces professionnels sont toujours plus nombreux à rejeter les injonctions à remplir des tâches aussi éloignées du métier qu’ils ont choisi et songent à démissionner.
Loin de résoudre la crise, les décisions technocratiques ne font donc souvent que l’aggraver. Pourtant, révolution numérique aidant, les pouvoirs publics pensaient avoir trouvé la parade : la e-médecine et le e-enseignement. Pourquoi donc des médecins et des enseignants – de toute façon, il n’y en a plus ! – quand une tablette et un logiciel peuvent si bien les remplacer à moindre coût ? Que n’a-t-on pas dit sur les MOOC qui autoriseraient chacun à suivre les cours de Harvard ou d’HEC ? Que n’a-t-on pas attendu des plateformes médicales, qui allaient permettre au patient, après avoir établi son diagnostic, de commander son traitement sur Internet ? Plus de médecins ? Plus de professeurs ? La belle affaire. La fée informatique s’occuperait de tout ! Las, la crise de la Covid-19 a montré que, seuls derrière leurs écrans, les élèves décrochaient, et que la e-médecine peinait à prendre en charge les malades, toujours plus nombreux dans les hôpitaux. Dans les deux cas, le « présentiel » a définitivement gagné la partie sur le « distanciel ». Il allait encore falloir compter avec ces soignants et ces enseignants hostiles à tous les changements et refusant les oukases de l’État administratif.
On peut certes stigmatiser le corporatisme des uns et des autres et celui de leurs syndicats. C’est, dans le fond, le discours technocratique dominant. Cependant il serait peut-être temps d’en sortir. Pourquoi ne pas aussi être attentif, par exemple, à la signification de ces oppositions et comprendre qu’elles renvoient aux cultures respectives de ces deux professions, fruits d’une longue histoire ?
Des résistances culturelles ancrées dans l’histoire
Leçon de l’histoire : depuis la Révolution française, médecins comme enseignants sont profondément attachés à l’exercice libéral de leur profession. Échappant désormais à la tutelle des corporations et de l’Église, ils revendiquent haut et fort une liberté dans laquelle il voit le symbole de la noblesse de leur métier. Les médecins ont ainsi toujours défendu le libre choix de leur lieu d’installation. Quant aux enseignants, fonctionnaires certes, nommés et recrutés par l’État, ils n’en ont pas moins constamment affirmé leur liberté pédagogique et, d’une certaine façon, leur indépendance par rapport à la hiérarchie, notamment s’agissant des professeurs du secondaire. Mais la défense de leur liberté professionnelle s’est accompagnée, chez les uns et chez les autres, de la réclamation d’un statut qui la garantisse en même temps qu’il définit leur profession, la protège et la hiérarchise. Paradoxalement, médecins et enseignants ont ainsi été conduits, en poursuivant les mêmes objectifs, à entretenir depuis deux siècles des relations symétriques avec les pouvoirs publics en organisant leur métier… sur le modèle corporatif.
Ainsi l’exercice de la médecine au xixe siècle est réglementé jusqu’en 1892 par la loi du 10 mars 1803. Garantissant à la profession son caractère libéral, elle réinstaure les examens abolis en 1794, contraint les praticiens à se faire enregistrer en produisant leurs diplômes universitaires ; ces derniers, après la création de l’université impériale en 1808, sont délivrés par les facultés de médecine. Parallèlement, la loi crée les officiers de santé, des médecins de second ordre, moins diplômés : contraints d’exercer dans leur département, ils ont en charge la santé de la France rurale dont les autorités ne se soucient guère qu’elle soit confiée à des praticiens aussi incompétents que le Charles Bovary de Flaubert.
La loi instaure donc, de fait, une médecine à deux vitesses. Ce sont ensuite les progrès de la science tout au long du siècle, mais également l’arrivée d’une nouvelle génération d’enseignants dans les facultés de médecine, disciples de Claude Bernard et de Pasteur, plus exigeants en matière de formation médicale, qui rendent caduc l’officiat de santé. La loi du 30 novembre 1892 le supprime et précise dans son article 1 : « Nul ne peut exercer la médecine en France s’il n’est muni d’un diplôme de docteur en médecine délivré par le gouvernement français à la suite d’examens subis devant un établissement supérieur médical de l’État. »
Le corps médical a donc obtenu des autorités, en un siècle, la garantie du monopole et de l’exercice libéral de la médecine. Mais la profession médicale remplit, qu’elle le veuille ou non, une mission de service public, à une époque, le xixe siècle, qui connaît une véritable révolution : l’État, désormais, se préoccupe de la santé de la population. Médecins et pouvoirs publics doivent donc s’entendre. Leurs intérêts respectifs ne sont cependant pas forcément divergents : avoir une clientèle solvable pour les premiers, permettre à tous l’accès aux soins pour les seconds, ce qui pose notamment la question de leur financement.
Au début du xixe siècle, alors que la couverture médicale est généralement faible, les médecins se plaignent de l’encombrement de leur profession. Or, comme le souligne l’historien de la médecine Olivier Faure, cet encombrement s’explique par le coût trop élevé des soins pour une partie de la population et aussi par la mauvaise répartition du corps médical7. Seules les classes aisées peuvent s’offrir les services des grands praticiens, les pauvres devant se contenter de ceux des officiers de santé ou des charlatans. Résultat : la médecine, pourtant attachée à la science et au progrès, obéit à la logique caritative la plus traditionnelle. Beaucoup de médecins, toujours assimilés aux prêtres au milieu du xixe siècle, n’accèdent pas à un niveau de revenu qui leur permette de se sentir appartenir à l’élite sociale.
Cependant, s’ils répugnent à l’exercice forcé de la charité, ils ne veulent en aucun cas renoncer au caractère libéral de leur métier. Pour faire entendre leurs revendications, dans la seconde moitié du xixe siècle, les médecins français vont développer des associations – comme pour les enseignants, il n’est d’abord pas question de syndicats –, dont la puissante Association générale des médecins de France en 1858. Elles choisissent la voie de la négociation pour définir les droits et obligations des praticiens à l’échelle des services municipaux pour les pauvres ou des sociétés de secours mutuel. Certes, les médecins répugnent à accepter une pratique contractuelle qui leur semble contraire à l’exercice libéral de leur profession, mais les associations ont saisi l’intérêt de la garantie de paiement et de l’augmentation du nombre de patients. Elles obtiennent d’ailleurs, en contrepartie, le principe du libre choix du soignant par le malade, autre pilier de l’exercice de la profession médicale en France.
Historiquement, médecins et enseignants entretiennent des relations symétriques et ambiguës avec les pouvoirs publics, fondées sur la défense de leur métier et de son libre exercice.
L’histoire de la médecine est ainsi celle d’une collaboration entre les représentants des praticiens et les autorités publiques. Celle-ci s’est finalement institutionnalisée avec l’autorisation de la création de syndicats de médecins par la loi du 30 novembre 1892, celle-là même qui supprime les officiers de santé, et la naissance en 1945 d’un nouvel Ordre des médecins, abolissant celui créé par Vichy en 1940, dont l’une des missions essentielles est précisément de conseiller les pouvoirs publics en matière de politique de santé.
S’agissant des enseignants, la Révolution française est également fondatrice. Ayant supprimé les congrégations religieuses, elle a été amenée à concevoir un corps de professeurs et un corps d’instituteurs entièrement laïques. Un siècle de combats et de réformes aboutit à la naissance de l’école républicaine avec ses maîtres rémunérés par l’État. Les enseignants remplissent une mission noble entre toutes – dans ce milieu laïque et fortement teinté d’anticléricalisme après l’affaire Dreyfus : instruire, émanciper et enraciner la République et l’amour de la patrie dans la conscience des jeunes Français.
Mais, si l’État dote ses instituteurs de tous les attributs d’un nouveau corps (une même formation dispensée dans les écoles normales, un diplôme, un lieu d’exercice et de résidence, un monopole professionnel – en dépit de la concurrence des congrégations – et un traitement), cela n’empêche pas le développement d’un certain malaise chez ces enseignants qui, épris d’égalité et de liberté, supportent mal l’arbitraire, le favoritisme et le poids de l’ancienneté. Les premières amicales, qui donneront naissance aux syndicats, portent d’ailleurs des revendications comme la dénonciation de l’autoritarisme de certains directeurs ou inspecteurs.
Le corps des instituteurs, forgé par l’État avec un objectif aussi bien social que politique, échappe ainsi à sa hiérarchie. Même s’ils s’en distinguent sur bien des points, les enseignants du secondaire – un corps fermé et hiérarchisé –, parviennent à la même émancipation et leur statut, qui prévoit un recrutement basé sur un barème de points dans le cadre d’un mouvement national, leur paraît la garantie de leur indépendance vis-à-vis des chefs d’établissement et le gage de leur liberté pédagogique. Au rythme de quatre ou cinq inspections dans une carrière pour toute évaluation de son travail, le professeur de collège ou de lycée peut en effet s’imaginer appartenir à une profession libérale… sans la rémunération correspondante.
Historiquement, médecins et enseignants entretiennent donc des relations symétriques et ambiguës avec les pouvoirs publics, fondées sur la défense de leur métier et de son libre exercice. Notons tout de même que ces principes ont souvent connu des entorses : pour pallier l’insuffisance du nombre de médecins au xixe siècle, on a instauré les officiers de santé et l’Éducation nationale, notamment depuis la massification du secondaire, a eu abondamment recours aux maîtres auxiliaires et autres contractuels dont les savoirs et les capacités professionnelles n’ont pas été sanctionnés par les sacrosaints concours. Notons également que la liberté d’installation pour nombre de médecins, au xixe siècle par exemple, a plus souvent été une fiction que la réalité en raison de son coût : beaucoup d’entre eux, leurs études achevées, regagnent leur pays natal où ils sont connus ou bien épousent la fille du praticien auquel ils succéderont. De même, l’indépendance de l’enseignant vis-à-vis de son chef d’établissement est plus fictive que réelle, ce dernier gardant la main, par exemple, sur l’attribution des classes et la confection des emplois du temps, qui conditionnent grandement les conditions d’exercice du métier.
L’histoire des professions médicale et enseignante explique donc leur hostilité à l’imposition d’un lieu d’installation pour les uns et à l’autonomie des établissements scolaires et de leurs chefs pour les autres, hostilité ardemment entretenue et défendue par leurs syndicats respectifs. Curieux paradoxe : au nom de la défense de leur liberté, ces deux professions ont encore ainsi un mode d’organisation très corporatiste, plus de 200 ans après la loi Le Chapelier qui a aboli les corporations…
Les mêmes réticences s’expriment chez les professionnels de la santé et de l’instruction à propos de la e-médecine ou du e-enseignement. Avec les conséquences de la numérisation, ils ont en effet le sentiment d’une perte de qualification ou, plus exactement, d’une remise en cause du fondement et de la légitimité de leur métier : leur savoir. Un fondement et une légitimité pour lesquels ils n’ont pourtant pas cessé de se battre et de vouloir se distinguer de la concurrence.
Historiquement, la relation médecin / patient et la relation professeur / élève reposent sur le même présupposé qui justifie sa verticalité : les premiers savent, les seconds ignorent. Certes, la pédagogie moderne fondée sur la méthode inductive (qui consiste à partir des représentations des élèves), sans oublier la classe inversée, dernière lubie de l’institution, a depuis longtemps sapé à la base l’autorité du maître, sommé de n’être plus que l’organisateur de situations, ludiques de préférence, permettant à l’apprenant de retrouver ce qu’il sait déjà ou de découvrir par lui-même ce qu’il ne sait pas. Mais l’utilisation du numérique accélère encore le processus. Et il n’est pas sûr que les résistances rencontrées chez les enseignants qui freinent l’avènement du « tsunami numérique » soient d’abord celles énoncées par Emmanuel Davidenkoff : les programmes trop lourds, les modalités de recrutement des professeurs, plus académiques que pratiques, et l’insuffisance de la formation initiale et continue8. Elles s’expliquent bien davantage par leur refus de renoncer à ce qui fait l’essentiel de leur métier : la transmission des connaissances.
S’agissant de la médecine, l’évolution est analogue et sans doute plus brutale encore que dans l’enseignement même si, depuis plusieurs années, les praticiens sont confrontés à des patients qui savent – ou croient savoir – et se comportent en clients exigeant la signature d’une ordonnance qu’ils ont pris soin de concevoir eux-mêmes. Dans La Révolution de la e-santé, Alexis Normand note ainsi que, si le rapport patient / médecin a changé, celui du patient à sa santé aussi9. En effet, avec les objets connectés et les applications médicales, le simple particulier dispose désormais d’instruments de diagnostic auparavant réservés aux soignants. En 2016, le Conseil national de l’ordre des médecins a d’ailleurs fait savoir son hostilité à une telle évolution. Voilà en effet le corps médical, comme les chauffeurs de taxi, confronté à un phénomène de disruption et à un risque d’ubérisation avec l’apparition de prestataires de santé non médicaux, s’appuyant sur des plateformes.
Doit-on, face à ces résistances, renoncer à toute évolution des pratiques de soin et d’enseignement ? Évidemment non. Mais, dans un cas comme dans l’autre, la collectivité pour laquelle les droits d’accéder à l’instruction et à la santé sont des acquis irréversibles a l’obligation de tenir compte de l’histoire, des transformations de la société et de la réalité des nouveaux outils, pour repenser, avec leurs professionnels, des métiers séculaires dont rien ne permet d’affirmer que leur disparition est possible ni souhaitable.
Comment les repenser ?
Il faut d’abord partir du principe que rien ne remplacera jamais le facteur humain dans l’exercice de la médecine et de l’enseignement et qu’il est sûrement une condition de leur efficacité – l’épidémie de Covid-19 est venue le rappeler.
Alors que « pédagogistes » et sociologues s’accordent pour minorer le rôle du professeur dans la réussite des élèves, celle-ci dépendant surtout selon eux de facteurs sociaux, les effectifs par classe et la mixité sociale, d’autres experts considèrent que l’ampleur de l’« effet enseignant » est supérieure à celle de l’« effet établissement ». En outre, dans un essai retentissant paru en 201610, Philippe Bihouix et Karine Mauvilly ont dénoncé « le désastre numérique » en s’appuyant notamment sur les résultats de l’enquête PISA menée en 2015, laquelle montre qu’en moyenne, pendant les dix années précédentes, là où on avait misé sur les technologies de l’information et de la communication, il n’y avait eu aucune amélioration notable des résultats scolaires des élèves en compréhension de l’écrit, en mathématiques et en sciences. Et les auteurs de se demander si, dans l’école numérique, l’élève n’est pas motivé par l’accessoire, l’outil lui-même, plutôt que par l’essentiel, la tâche d’apprentissage.
Quant à la médecine, depuis la « naissance de la clinique » (Michel Foucault), elle s’exerce au chevet du patient. Le praticien, à l’écoute de ses symptômes, l’examine attentivement. Et tout son talent consiste alors à poser le bon diagnostic. Roger Martin du Gard en donne une saisissante représentation dans Les Thibault quand Antoine, appelé au chevet de la jeune Dédette renversée par un triporteur et sur le point de mourir, se livre à un examen attentif de son corps, « ses doigts remontant lentement le long de la cuisse », découvrant « tout à coup par une plaie imperceptible qui se trouvait sur la face interne de la jambe11 » la cause de son mal et lui sauvant la vie.
Il y a, dans les pratiques médicale et pédagogique, quelque chose qui renvoie aux origines religieuses de ces deux professions. Certains médecins et enseignants ne passent-ils pas pour « faire des miracles » ? Ce n’est naturellement pas une raison pour rejeter les outils numériques, mais cela signifie qu’ils ne se substitueront jamais aux professionnels comme l’espèrent parfois les gestionnaires. Emmanuel Davidenkoff le dit fort bien dans le cas de l’enseignement : renouveler l’école par les technologies digitales ne signifie pas remplacer le professeur par la machine. Les nouveaux outils permettent certes une interaction mais ils ne peuvent donner le meilleur d’eux-mêmes qu’avec une médiation humaine.
S’agissant de la télémédecine, le processus est en passe de devenir une réalité et, à la suite d’un accord passé entre la Sécurité sociale et les syndicats médicaux, les téléconsultations sont possibles partout en France depuis septembre 2018. Mais la télémédecine n’est pas la e-santé, car le médecin ne disparaît pas. Cela n’implique d’ailleurs pas la fin des rendez-vous dans les cabinets médicaux ; ce peut être un recours utile aux patients peu mobiles ou âgés, et faciliter aussi l’accès à un praticien dans les zones sous dotées. Néanmoins, le patient conserve sa liberté : aucune consultation à distance ne pourra lui être imposée.
Médecins et enseignants ne vont donc pas disparaître, simplement leur pratique est appelée à se modifier et le numérique n’est pas contradictoire avec leur revendication d’autonomie.
Mais la technologie n’est pas tout. Elle ne saurait dispenser de repenser en profondeur l’exercice de la profession médicale et enseignante si l’on veut que l’égalité de l’accès aux soins et à la formation ne soit plus un songe creux, avec ses conséquences politiques prévisibles.
Dans les deux cas, une grande partie de la solution viendra du recul de la bureaucratie et du décloisonnement. Recul de la bureaucratie d’abord : les médecins veulent soigner, les professeurs enseigner, et rien n’est venu démontrer que la suradministration de ces domaines était un gage de la qualité des services rendus, au contraire. Elle est en revanche le signe d’une méfiance des instances de tutelle à l’égard de ces professionnels et une source de découragement pour beaucoup d’entre eux.
Décloisonnement ensuite. Et sur ce terrain-là aussi la médecine comme l’école ont beaucoup de retard. Des idées existent cependant : ainsi le rapport Borloo d’avril 2018 préconisait-il la création de « cités éducatives » dont le principe consiste à mettre en réseau les différents acteurs qui interviennent dans la formation des jeunes ; il peut s’agir de centres sociaux, de loisirs, de santé. La gestion de ces cités éducatives devrait être décentralisée et basée sur le principe de l’autonomie – une révolution dans l’éducation. À charge pour les chefs de ces établissements de recruter et de motiver leurs équipes, par exemple avec des primes et des avantages définis à l’échelle locale. Il ne s’agit donc pas de faire sans les enseignants, au contraire. Il s’agit de faire travailler en synergie des professionnels de différents domaines plutôt que de laisser chacun s’épuiser dans le sien. Cela suppose effectivement une transformation des structures, mais qui peut dire qu’elle est incompatible avec la liberté pédagogique du professeur retrouvant ainsi le cœur de sa mission, liberté et mission auxquelles se rattache toute l’histoire de la profession ?
S’agissant de la médecine, dans un ouvrage paru en mai 2018, le président du Conseil national de l’ordre des médecins, Patrick Bouet, alertait sur un système au bord de la rupture et soulignait que l’accès équitable aux soins pour tous n’existait plus. D’après lui, le remède consiste à décloisonner le public et le privé, la médecine de ville et l’hôpital, le médical et le paramédical, alors que souvent les acteurs jouent les uns contre les autres, ce qui n’est un gage ni d’efficacité ni d’économie.
Des points communs se dégagent ainsi entre les principes qui doivent guider la transformation de l’enseignement et de la médecine : recul de la bureaucratie, décloisonnement, autonomie et finalement confiance dans les acteurs. Naturellement une telle transformation en appelle une autre : celle des statuts de leurs professionnels, fruits d’une longue histoire.
Des raisons d’être pessimiste ? Pas nécessairement, car les siècles passés enseignent aussi que ces statuts, au cours du temps, n’ont pas cessé de se transformer pour s’adapter aux bouleversements de la société et aux revendications des médecins et des enseignants. Or aujourd’hui ces derniers sont en quelque sorte sommés de changer leurs pratiques pour répondre au défi du numérique, sans oublier celui de l’intelligence artificielle. Un exemple parmi d’autres : la télémédecine n’est-elle pas un moyen de participer à la lutte contre les dangers de la e-santé soulignés par Alexis Normand et notamment la perte de la souveraineté numérique, dont la défense est l’affaire des États ? Une fois encore, comme souvent depuis deux siècles, professionnels de santé et autorités publiques ont des intérêts communs. Comment pourrait-il en être autrement, puisque soigner et instruire sont des tâches qui concernent la collectivité tout entière ? Ces deux domaines sont des enjeux décisifs pour le pouvoir depuis la Révolution française au moins. Les réparer devrait donc être une priorité.
Pourquoi finalement ne pas être optimiste ? Leur pratique va se transformer mais la médecine et l’enseignement sont deux métiers d’avenir. On peut même raisonnablement espérer que cette transformation résoudra la crise qu’ils traversent et contribuera ainsi à la réduction de la fracture sociale et politique que connaît la France depuis de trop longues années.